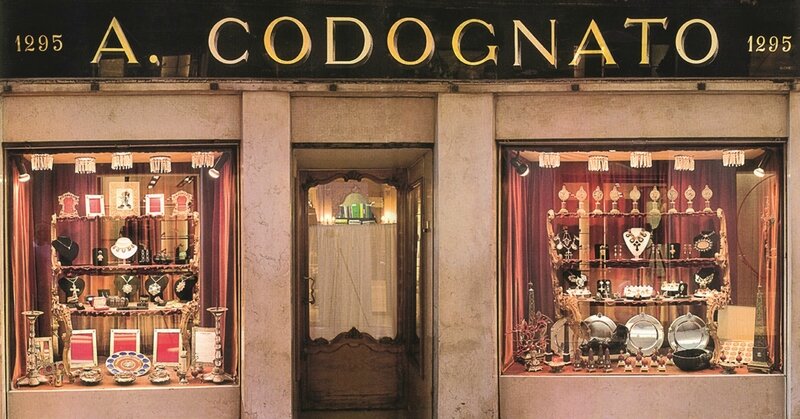Comme à son habitude, Tom Andriamanoro aborde, dans sa chronique hebdomadaire, divers sujets rattachés directement ou indirectement à l’actualité.
Horizon 2018 – À chaque jour ne suffit plus sa peine
Comment peut-on se préoccuper d’un futur pas encore si proche, quand on n’arrive même plus à assurer le présent C’est tout à fait possible quand on est les seuls vrais Gondwanais, attestés par les débris de la dérive des continents, lesquels ont laissé, dans leur débâcle, la trace d’un pied fuyard. Toute la classe politique ne jure plus que par 2018, que l’on soit pour ou contre. On pousse ses pions, qui en trichant sur la ligne en raison du silence inquiétant du starter homologué, qui en jouant à l’impavide peu soucieux de l’avance prise par la concurrence. « Tombon-dàlana ny an’ny sarety », laissez passer les charrettes, elles n’iront pas bien loin…
Chez les anti-élections, du moins ceux qui ne sont pas convaincus de leur opportunité, un mot revient à la boucle dans les médias, les cercles de réflexion, les entrevues, les conférences publiques, sans que tous soient conscients de la difficulté d’une tâche quasi titanesque : celui de « refondation » préalable. La définition la plus rapide ramène le concept au retour à une malgachéité aussi bien des raisonnements que des systèmes, tout en restant encore flou sur certains points, excepté la revalorisation du Fokonolona. La référence à Richard Ratsimandrava est bien facile, puisque le temps ne lui a pas été laissé de confronter ses idées à la pesanteur des réalités. La tentation aussi est grande de mettre ce besoin identitaire au moule du courant nationaliste qui revient au tout premier plan dans de nombreux pays. Certes, les slogans du genre « America first » de Trump, ou « La France aux Français » de Marine Le Pen, sans oublier les coups de massue de Frauke Petry l’anti-Merkel, ou les envolées de Milorad Dodik lors de la Journée de la souveraineté de la République serbe de Bosnie ne détonneraient pas dans la bouche d’Otrikafo ou d’un James Ratsima. Mais la réalité gondwanaise est autrement plus compliquée, et la définition la plus complète, du moins au jour d’aujourd’hui, est celle donnée par Mgr Odon Razanakolona quand il parle de « revoir la fondation de notre maison commune (…) de manière inclusive, en partant de la base sociale pour favoriser l’appropriation du processus par la population, et permettre la mise en place d’une Nation forte avec des institutions reconnues par tous ». Question à autant d’ariary que l’on voudra : qui en sera le maître d’œuvre pour donner au processus un caractère officiel imposable à tous, et faire en sorte que les résolutions ne restent pas lettres mortes, comme tant d’autres « fihaonambem-pirenena » du temps passé ?
Il est inutile de compter, pour ce faire, sur les gouvernants actuels, dont les préoccupations et priorités connues de tous sont (déjà) ailleurs. On ne les voit pas non plus céder tout ou partie de la place à une structure transitionnelle chargée de cette refondation, et qui équivaudrait ni plus ni moins à un aveu d’échec de leur part. N’en déplaise donc aux anti-2018, et à moins qu’un bouleversement ait lieu entretemps, la seule voie possible serait qu’un vrai réformateur arrive au pouvoir par la voie des urnes, avec pour programme de base un mot qui veut tout dire : Re-fon-da-tion. Une fois élu, il initiera une approche sectorielle, en commençant par révolutionner la fonction ministérielle dont le titulaire sera le catalyseur d’une concertation inclusive dans son domaine respectif, associant aux réflexions les compétences et représentations nationales jugées indispensables. Loin des « tora-po » arbres à palabre, on aboutira à une refondation du système d’éducation, une refondation de la santé, une refondation de la culture, une refondation des problèmes fonciers, une refondation de la justice, ainsi de suite. Le tout sera rassemblé dans un document-projet à soumettre à référendum, car le dernier mot doit rester au peuple délégataire du pouvoir.
On ne m’en voudra pas de partager la conviction d’un homme politique français de la nouvelle génération, pour qui toute grande refondation doit partir d’une offre politique. « Il faut clarifier les choix et, en même temps, dénoncer les impostures sur beaucoup de sujets, économiques, sociaux, géopolitiques. Il faut surtout continuer à expliquer, à donner du sens, à proposer, de manière bienveillante et ouverte. » Et si cela ne passe toujours pas, car les habitudes, la démagogie, l’esprit de clocher et, au passage, les espèces sonnantes ont la vie dure Eh bien, tout simplement tant pis, on ne fera pas le lit des Gondwanais ronfleurs à leur place.

Yahya Jammeh est tombé de son piedestal.
Leçons de l’histoire – La guerre de Troie n’aura pas lieu…
Cette œuvre de Jean Giraudoux fait revivre l’insouciance de la ville de Troie assiégée par les Grecs après l’enlèvement de la belle Hélène. Sûrs d’eux, les Troyens l’étaient derrière la puissance économique de leur cité, la qualité de leurs troupes, l’épaisseur de leurs murailles. La grande distraction était, d’ailleurs, d’aller sur ces fortifications en fin d’après-midi comme les Majungais sur leur corniche, pour voir si ces fous de Grecs étaient encore là. Et jusqu’à la toute dernière ligne du livre, ils étaient sereins, plaisantant même sur cet étrange cheval géant en bois que l’ennemi était en train de construire. Seul le lecteur, connaissant la suite de l’histoire, savait que la guerre de Troie aurait bien lieu…
En Gambie, au contraire, tout le monde s’attendait à une guerre de Banjul, la capitale après les résultats des présidentielles, mais il n’y eut pas la moindre escarmouche. Un drôle de micro-pays que cette Gambie épousant les méandres de son unique fleuve, avec, pour voisin le Sénégal au Nord, le Sénégal à l’Est, le Sénégal au Sud, et l’Atlantique à l’Ouest ! Sur une carte on aurait dit un serpent, ou plutôt un intestin, ou plutôt un ver dans le fruit. Quant au dictateur Jiahia Jammeh tombé de son piédestal, il n’a jamais fait que se préparer à une guerre hypothétique depuis que, jeune lieutenant, il a renversé le président Dawda Jawara en 1994. Il surarmait son pays auprès de fournisseurs comme l’Iran, le Nigeria, la Russie, la Mauritanie, ou la Turquie.

Dama Barrow a battu le président en exercice, mais la guerre de Banjul n’a pas eu lieu cependant.
Et après sa défaite électorale face à Adama Barrow, il multiplia ses préparatifs avec l’enrôlement de combattants du Mouvement dissident casamançais MFDC, ainsi que de mercenaires venus du Liberia. Ses propres troupes, il les galvanisait à grand renfort de rodomontades et de libations. Quant à lui-même, il était un fervent adepte des bains mystiques et du recours aux amulettes. Mais la guerre de Banjul n’eut pas lieu, Jahia Jammeh ayant dû se plier aux injonctions de la CEDEAO, et partir en exil non sans avoir fait main basse sur les caisses de l’État. Comme l’écrivait le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, « l’Histoire enseigne que les autocrates et les despotes sanguinaires finissent toujours en lâches ».

Cette eau de pluie, véritable don du ciel, finit dans les courettes des bidonvilles où elle charrie des saletés.
Climat – Un peu d’eau, beaucoup d’idées
Jacques Hannebique, un zanatany déjà parti retrouver les ancêtres, se souvenait, en ces termes, des légendaires orages de fin d’après-midi à Antanana-rivo : « Après un prélude wagnérien de roulements de tonnerre et d’éclairs aveuglants, les vannes du ciel s’ouvrent et tombent les premières gouttes, énormes et largement espacées. Chacune marque le sol d’un petit cratère, en une mini-explosion de poussière assoiffée et d’eau bénéfique. Quelques instants après, le déluge s’installe dans toute sa puissance.
Le réseau d’évacuation n’a pas été conçu pour négocier les énormes débits qui surviennent dans les quelques instants d’un violent orage. Toute cette eau du ciel s’accumule, engorge tout le système hydraulique et le très large supplément provoque des inondations locales, éphémères certes, mais qui paralysent pendant quelques heures tel ou tel quartier. Les effets peuvent être très divers : gênants, désagréables, amusants, ou inattendus comme quand les flots envahissent un bar de dernière catégorie. Dans l’eau jusqu’à mi-jambe, les clients, habitués des lieux, relèvent le pantalon et continuent de boire tranquillement. Ils sont philosophes. Tout à l’heure, demain, toute cette eau sera partie, alors pourquoi se faire du souci Buvons ! »
Le pittoresque n’a aujourd’hui plus lieu d’être. Un peu partout dans le pays et quelles que soient les pluviométries, le constat est à un énorme gâchis, faute d’une réelle politique de maîtrise et de bonne utilisation de l’eau, dont celle de pluie. Cette eau de pluie, véritable don du ciel qui finit dans les égouts quand ils existent ou ne sont pas bouchés, dans les courettes des bidonvilles où elle charrie des excréments quand ils n’existent pas. Cette eau de pluie qui, aussi rare soit-elle, a permis à d’anciennes civilisations du désert d’accomplir de véritables miracles. C’est le cas de la ville de Pétra en Jordanie, qui date du Ier siècle av. J.C et fut redécouverte par les archéologues en 1812.
Halte caravanière réputée, Pétra dans le désert du Sud-Ouest de la Jordanie, possédait un bassin plus grand qu’une piscine olympique, alimenté par un système ingénieux d’irrigation artificielle. L’eau ainsi domptée permettait, non seulement, de pourvoir aux besoins fondamentaux de la cité en multipliant les fontaines, mais aussi de s’accorder des extras comme arroser de somptueux jardins publics. Les archéologues ont remis au jour des conduits souterrains destinés à réguler les débordements en saison des pluies, tandis qu’un réseau complexe de canalisations en céramique, de citernes, de réservoirs souterrains filtrait l’eau et autorisait la culture de fruits et de céréales, ainsi que la production de vin et d’huile d’olive en plein désert. Les caravanes venues du Golfe avec leurs précieuses cargaisons avaient hâte d’arriver à Pétra, synonyme de nourriture, de gîte, et surtout d’eau fraîche. Mais rien de tout cela n’était gratuit, et les caisses de la ville n’en finissaient pas de se remplir. Et pourtant…
Et pourtant Pétra ne recevait que 10 à 15 centimètres de pluie par an, moins que notre Sud. Mais la moindre goutte était récoltée et orientée vers les canalisations qui déversaient l’eau dans des centaines de citernes en sous-sol garantissant tous les bienfaits depuis l’alimentation jusqu’aux bains, en passant par l’arrosage des jardins, en toutes saisons. Pétra dont le nom signifie « rocher » sut cultiver sa prospérité jusqu’au jour où Rome en prit possession en 106 de notre ère. Elle ne parvint alors plus à soutenir la concurrence de la voie maritime de plus en plus commode pour le négoce, et dépérit inexorablement sous l’assaut de ce qui était en fait son élément naturel : les sables du désert…

Patrick Sabatier et son épouse.
Rétro pêle-mêle
-Patrick Sabatier, l’animateur le plus novateur en concept de production télé du dernier quart du vingtième siècle, est surtout resté dans les mémoires françaises grâce à son émission « Atout cœur ». Elle lui a donné l’opportunité de séjourner à Madagascar,
« un voyage extraordinaire, en Premiér classe, avec une réception à l’arrivée, et un programme incluant Nosy Be et Toliara, en plus de la capitale ». À Nosy Be, il se souvient de l’herbe verte s’étendant vers le sable et le bleu de la mer, d’un bassin de crocodiles dans le jardin, et d’une escapade vers les Mitsio. Interrogé sur la misère dans les rues d’Antananarivo, il a été franc : « À Cuba où il y a aussi beaucoup de pauvreté, j’ai trouvé que les gens étaient foncièrement optimistes. À Madagascar, ce n’est pas le cas, il y a une sorte d’agressivité, comme une révolte latente. »
-Plus connu sous l’appellation vulgarisatrice de Langues’O, l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) est la seule Institution en Europe dispensant l’enseignement de la langue, de la littérature, et de la civilisation malgache. Enseigné depuis 1898, le malgache y a connu un développement notable depuis 1980 avec néanmoins une certaine baisse dans les années 90. Les études y sont basées sur la connaissance du malgache officiel classique, la littérature écrite et orale, ainsi que l’arabico-malgache. Depuis 1993, le prestigieux établissement est habilité à délivrer les diplômes nationaux de licence et de maîtrise en malgache. Faut-il rappeler que notre langue se rattache à la famille linguistique austronésienne, mais avec des emprunts au sanscrit et un apport lexical important de la famille bantu et des langues européennes.
Textes : Toma Andriamanoro
Photos : Archives Express de Madagascar – AFP