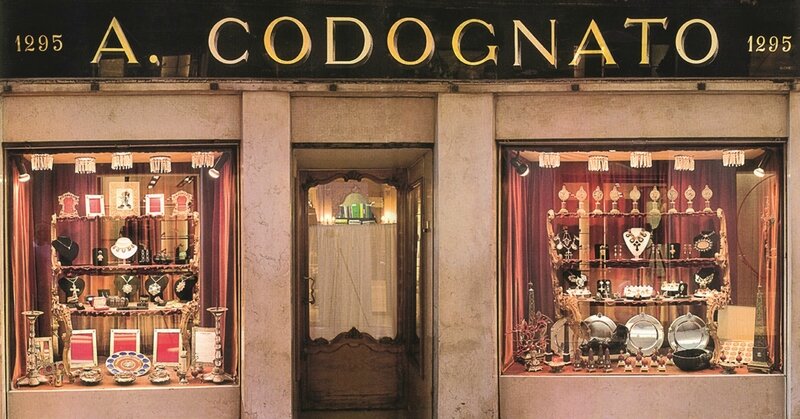La responsable média au sein de Focus Development explique la situation des apatrides à Madagascar. Elle ne manque pas d’avancer quelques pistes de réflexion pour résoudre leurs problèmes.
Quel est l’objectif de Focus Development en militant en faveur du droit à la nationalité des apatrides ?
Certaines personnes pensent que nous militons en faveur des riches Karana, Pakistanais et Indiens. Mais à Madagascar, il y a cinq communautés différentes de Karana et il n’y a pas forcément de relations entre elles. D’ailleurs, les Karana richissimes ont déjà une nationalité étrangère ou malgache. Ceux qui n’ont pas les moyens, financiers, cela s’entend, demeurent pour leur part des apatrides. La plupart d’entre eux, sinon tous, sont issus de la troisième génération. Notre but est à la fois de régler la situation de tous les apatrides quels qu’ils soient, et de lutter contre la discrimination.
• Justement, outre les apatrides d’origine pakistanaise et indienne, existe-t-il d’autres communautés qui en sont victimes ?
Ce sont les Karana qui sont les principales victimes d’apatridie car ils seraient les plus nombreux. Leur principal problème est que les gouvernements indien et pakistanais refuseraient de leur accorder leur nationalité tant qu’ils ne reviennent sur la terre de leurs ancêtres. La plupart de ces Karana seraient originaires de l’État indien de Gujarat. La majorité n’a pourtant pas les moyens d’y aller et, en fait, ils ne veulent pas tout simplement avoir une nationalité autre que malgache. Leurs ancêtres sont enterrés à Madagascar. Les personnes d’origine comorienne constituent le second groupe de victimes d’apatridie à Madagascar. L’archipel des Comores et Madagascar ne constituaient qu’une seule province à l’époque coloniale. Et quand l’Indépendance est instaurée en 1960, les deux pays ont été séparés sur le plan administratif. Certains Comoriens n’ont pas voulu retourner aux Comores et ont fait souche dans la Grande île. La plupart de leurs descendants sont ainsi devenus des apatrides. Ils ne veulent pas retourner aux Comores et ne connaissent même plus les membres de leurs familles qui résident sur l’archipel. On recense aussi des apatrides d’origine arabe, plus précisément issus du Moyen-Orient, mais en général, on les confond avec les Karana. Enfin, il y a certains enfants métis et descendants de Chinois apatrides.
• Leurs lieux de résidence sont-ils localisés de manière spécifique ?
Il semble que des apatrides vivent aux quatre coins de l’île. Mais nous travaillons essentiellement dans les ex-provinces de Mahajanga et de Toliara où il y aurait beaucoup d’apatrides, même si nous n’avons aucune statistique aujourd’hui. Dans la capitale, leur nombre serait moins important.
• De prime abord, ils ne semblent avoir aucun problème au sein de la société, pouvez-vous évoquer les principales difficultés qu’ils rencontrent au quotidien ?
C’est normal s’ils ne sont pas sous les feux des projecteurs des médias ou le centre d’intérêt de la société. Ils sont transparents car ils n’existent pas sur le plan administratif. La plupart des apatrides exercent dans le secteur informel, faute de papiers administratifs. Et comme les activités informelles sont les plus nombreuses à Madagascar, ils ont pu s’intégrer facilement. En revanche, les enfants apatrides ne pourront pas aller bien loin dans leurs études, par exemple à l’université, ni voyager.
• Quelles est la position adoptée par les autorités vis-à-vis des apatrides ?
Nous pensons que certaines autorités profitent d’eux. Ces derniers sont, en quelque sorte, les principales sources de corruption à tous les niveaux et parfois légalement. Est-il normal de les obliger à avoir une carte de résident destinée aux étrangers, alors que leurs familles sont à Madagascar depuis près d’un siècle puisque leurs ancêtres sont arrivés au début de la colonisation Afin d’obtenir également une carte d’identité nationale, ils sont obligés de payer une somme d’argent importante aux autorités. Certains ont épousé légalement une ou un Malgache. Comment cela a-t-il pu se faire alors qu’il ou elle est apatride et n’existe pas sur le plan administratif Et pour avoir un document de voyage, ils sont astreints à payer une forte somme d’argent.
• Leur accorder la naturalisation constitue-t-il un avantage ou une menace pour le pays d’accueil ?
Je ne veux pas me hasarder à avancer une réponse à cette question. Tout ce que je peux vous dire est que certains pays « vendent » leur nationalité aux étrangers, à l’instar l’île Maurice, des États-Unis ou de la Croatie, et voyez où en sont ces pays aujourd’hui en termes de développement. On leur accorde, en effet, la nationalité à condition qu’ils fassent des investissements économiques et contribuent au développement du pays. A Madagascar, les apatrides passent leur temps à corrompre les autorités.
Un code de nationalité qualifié de discriminatoire
Focus Development pointe du doigt l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache. Plusieurs points y sont qualifiés de discriminatoires en plaçant des centaines de personnes dans un état d’apatridie. Les femmes malgaches mariées légalement à un étranger, ne peuvent pas, dans plusieurs cas, transmettre leur nationalité à leurs enfants, selon cette ordonnance », précise Mina Rakotoarindrasata. Le délit de faciès et de patronyme y est également mis en exergue.
Selon l’article 9 de ce texte, est malgache l’enfant légitime né d’un père malgache, l’enfant légitime né d’une mère malgache et d’un père qui n’a pas de nationalité, ou dont la nationalité est inconnue. Dans l’article 10, un enfant est aussi malgache quand il est né hors mariage d’une mère malgache. L’article 11 est l’un des points qui indigne Focus Development. « Est malgache l’enfant né à Madagascar de parents inconnus dont on peut présumer que l’un au moins est malgache. Pourront notamment être pris en considération le nom de l’enfant, ses caractères physiques… », stipule le Code de nationalité. Mais le gouvernement peut aussi, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité, indique l’article 17 de la même loi, soit pour indignité, défaut ou insuffisance d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.
La naturalisation suscite aussi un débat. Selon l’article 27, elle ne pourra être accordée qu’aux étrangers remplissant les conditions suivantes, à savoir avoir 18 ans révolus, être sains d’esprit, ne présenter aucun danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique…
Afin de remédier à ces situations qualifiées de discriminatoires, Focus Development a mené un travail de sensibilisation à la Chambre basse, mardi, pour que soit réactualisé le Code de la nationalité malgache. « Il y a eut une cinquantaine de députés durant la séance et ils étaient d’accord pour mettre le texte à jour. Mais c’est encore un travail de longue haleine », conclut Maika Mahazaka-Fandresena, responsable média de Focus Development.
Le Monde au chevet des apatrides
Des représentants du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’Equal Rights Trust se trouvent à Madagascar, cette semaine, afin de mener des travaux de lobbying pour mettre fin à l’apatridie. « L’apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation », explique Joanna Whiteman, représentante d’Equal Rights Trust. C’était mercredi, lors d’une rencontre avec les membres de la société civile et les communautés apatrides à Antaninarenina. Afin de mettre un terme à l’apatridie, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en partenariat avec des organisations non gouvernementales internationales et locales, a élaboré un plan d’action 2014-2024.
Dix actions sont identifiées. La première est de résoudre les situations majeures existantes d’apatridie. Dans ce cadre, des plaidoiries sont à mener auprès de la population et du gouvernement, notamment, pour la réforme des lois, des politiques et des procédures relatives à la nationalité, afin de permettre l’acquisition de la nationalité par les apatrides. Des appuis au gouvernement, Parlement et société civile ainsi qu’aux apatrides seront également apportés, à savoir une assistance juridique et un soutien aux campagnes sur la nationalité afin d’aider les apatrides à déposer une demande de nationalité et à obtenir des documents qui confirment leur naturalisation.
La deuxième action est de faire en sorte qu’aucun enfant ne naisse plus apatride. La fin de la discrimination, basée sur le genre, de la législation sur la nationalité entre également dans le plan d’action. La prévention de l’apatridie dans les cas de succession d’États est également inscrite dans ce plan d’actions du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Un point saillant consiste aussi à accorder le statut de protection aux migrants apatrides et à faciliter leur naturalisation. Parmi les objectifs de ce plan décennal, citons également la délivrance d’un certificat de nationalité et autres documents qui attestent leur nationalité aux personnes qui sont aptes à la naturalisation. Les États seront, par la suite, invités à adhérer aux conventions des Nations unies relatives à l’apatridie, car cette adhésion constitue une opportunité de résoudre en partie le problème de l’apatridie. Selon l’article 137 de la Constitution de 2010, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…